Charlotte Foucher Zarmanian est l’auteure de l’ouvrage Créatrices en 1900. Femmes artistes en France dans les milieux symbolistes, publié à Paris, chez Mare & Martin en 2015, suite à une thèse soutenue en 2012 à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle est aujourd’hui chercheure au CNRS membre permanent du LEGS (le laboratoire d’études de genre et de sexualité), et membre associée du laboratoire InTRu, de l’université François-Rabelais de Tours, où elle a commencé son parcours universitaire.
Pourriez-vous nous expliquer votre parcours, la genèse de vos recherches et les raisons du choix du sujet des femmes dans l’histoire de l’art ? Y-a-t’il eu un élément déclencheur à cela ?
J’ai un parcours somme toute assez linéaire, un parcours universitaire, du début à la fin : j’ai fait toutes mes études à l’université François Rabelais de Tours. Le moment de prise de conscience de la présence, ou de l’absence des femmes dans l’histoire de l’art, ça a été grâce à un cours de troisième année de licence, qui a été dispensé par Giovanna Zapperi (qui est maintenant professeure à l’université de Tours, mais qui était ATER à ce moment-là), portant sur le genre et l’art contemporain. Il s’agissait d’un cours optionnel, que j’ai pris : je me souviens qu’il avait lieu le vendredi après-midi, on était très peu à prendre ce cours, car tout le monde devait prendre son train. On était donc en petit comité, ce qui a rendu le cours agréable et marquant. Il m’a donné ensuite envie, en master, de m’intéresser plus aux femmes artistes. J’aimais l’art du XXème siècle, mais j’aimais aussi beaucoup l’art du XIXème siècle et grâce à ce cours j’ai pu lire les travaux de Linda Nochlin, de Griselda Pollock (qui sont tout de même des historiennes de l’art qui se sont intéressées plutôt au XIXème siècle), donc j’ai choisi de travailler sur ce siècle. J’ai fait un master I qui était une monographie, un master II aussi. J’ai réalisé mon master I sur Jeanne-Elisabeth Chaudet, une femme artiste de l’époque post-révolutionnaire, qui était l’épouse d’Antoine Denis Chaudet, l’un des sculpteurs favoris de Napoléon Ier et mon master II sur Elisabeth Sonrel qui était une artiste symboliste, donc plutôt de la fin du XIXème siècle. Ce qui m’a fait choisir ces deux époques très différentes, – parce qu’on ne voit pas forcément la continuité -, ce sont en fait les directeurs et directrices de mémoires. Pour le master I c’était France Nerlich, qui venait d’arriver à Tours et pour le master II, il me fallait quelqu’un qui puisse me suivre en thèse, alors j’ai profité du retour de Pascal Rousseau. Lui est plutôt spécialiste fin XIXème, XXème voire aujourd’hui XXIème siècles ; après discussion, on en a conclu qu’il y avait quelque chose à faire sur le passage du siècle. Le terrain est balisé sur les avant-gardes, il y a eu beaucoup de travaux, m’a-t-il dit, et je me suis lancée dans la toute fin du XIXème siècle. Par Sonrel, artiste de Tours, ancrée dans un contexte régionaliste, j’ai pu ouvrir le champ aux femmes dans les milieux symbolistes.
Cette thèse, devenue un essai, a-t-elle évoluée dans sa réécriture ? Que se permet-on davantage dans la publication d’un ouvragé issu d’un travail de recherche universitaire ? Ou au contraire, se restreint-on ? Comment se libère- t-on du cadre de la thèse pour aller vers un travail plus personnel ?
Alors ça, ça a pris du temps, et je voulais que ça prenne du temps. Entre ma soutenance qui a eu lieu en décembre 2012 et l’essai qui a été publié en 2015, je me suis consacrée à l’enseignement, j’ai mis à distance mes recherches et ça m’a fait du bien, j’avais besoin de ce moment de recul. La thèse prend beaucoup de temps, d’espace et j’étais très heureuse de retourner à l’enseignement. J’ai fait mes deux ans d’ATER à l’université de Tours, et ensuite je suis tombée enceinte. Le congé maternité a été un moment propice de temps pour soi et je me suis dit, c’est le moment de reprendre un peu ce travail. Je me rendais compte que depuis quelques temps il y avait un intérêt du public, des institutions pour ces questions-là, donc j’avais envie de porter à la connaissance mes travaux, mais de manière accessible, ça c’était vraiment important pour moi. Je ne voulais pas faire quelque chose de redondant avec la thèse : pour moi il existe la thèse, avec toutes ses annexes, toutes ses notes de bas de pages, avec cette lourdeur, – mais qui était nécessaire ! – alors que quelque chose de plus digeste était souhaité. Envisager un livre qui pourrait se lire, pourquoi pas, dans le métro. Il s’agit donc d’un travail qui s’est accompagné d’une réécriture plus vivante, c’est un vrai choix, sans pour autant en gommer les complexités, faire un tri iconographique, s’occuper seule de tous les droits liés aux images et donc faire dialoguer les images et le texte. Les œuvres sont centrales dans mon travail, donc je ne voulais pas d’un petit cahier, au milieu, à part. Et bien sûr, réduire considérablement l’ouvrage…
Vous avez également gagné le Prix du Musée d’Orsay…
Oui, alors ça, ça a été vraiment facilitateur, mais même si le prix octroie de l’argent, il a fallu se lancer dans la bataille de trouver un éditeur, ce qui n’est pas évident : aujourd’hui il y a très peu d’éditeurs qui acceptent de publier des travaux de jeunes chercheurs ou chercheuses. À cette période-là je n’avais pas de poste, donc je n’avais pas forcément de légitimité ou de statut, ce qui rend les choses plus complexes. Les éditeurs sont très friands de ce qui peut être commercialisés autour des expositions, mais quand il s’agit de valoriser les travaux de jeunes docteurs, même s’ils ont été récompensés, c’est plus difficile… Ce genre de travail n’a rien de lucratif !
Quel a été le retentissement de votre ouvrage principal ? Et pourrions-nous aborder d’autres travaux importants ?
Ce qui m’a fait plaisir, c’est que ce livre a eu un impact, plus important à l’étranger, bizarrement, – ou pas bizarrement ! – qu’en France, mais grâce à la publication, j’ai été invitée à Madrid au Musée Thyssen pour donner une conférence, à Namur à l’occasion d’un exposition sur les femmes artistes belges, aux Etats-Unis quelques recensions ont été faites, en Suède étonnamment mon ouvrage s’est retrouvé dans un quotidien du type Le Monde, ainsi que d’autres choses un peu étonnantes, en Italie… et en France, ça a été un peu plus lent, c’est moi qui ai contacté les revues. L’élan spontané est plutôt venu de l’étranger
Publier sa thèse, c’est la fin d’une grande aventure, aussi personnelle, alors j’ai eu besoin de collaborations, d’ouvrages plus collectifs. Dans le cadre de mon projet au CNRS, qui portait sur le lien entre femmes et musées, j’ai contacté mon collègue
Arnaud Bertinet, qui est maître de conférences à Paris I, car je me sentais légitime à parler des femmes, mais moins des musées. L’idée était de construire quelque chose dans le prolongement de la thèse mais qui la dépasse également, qui embrasse un champ nouveau, inédit, non traité. Les femmes artistes, il y a de plus en plus de choses, c’est très bien, les gens s’en emparent. Et finalement, il y a quelque chose à faire avec toutes ces femmes médiatrices du monde de l’art, celles qui ne pratiquent pas l’art mais qui en font partie dans sa mise en valeur. Au début, je me suis intéressée aux historiennes de l’art seulement, ce qui a pu sembler un petit peu trop réducteur au jury pour un projet porté sur dix ans ; j’ai donc élargi le projet aux intellectuelles dans les mondes de l’art (critiques, théoriciennes, collectionneuses, historiennes de l’art, conservatrices du patrimoine, bibliothécaires) entre 1850 et 1950 environ. La muséologie pose très peu la question du musée en termes de genre. Un premier article est paru dans la revue Romantisme, qui faisait paraître un numéro thématique ; l’article a été accepté tout de suite, je me suis alors dit qu’il fallait que je monte un numéro de revue et le projet collectif s’est enclenché. Moi, je ne voulais pas que ce soit dans une revue féministe ou de genre, il fallait que ce soit dans une revue musée, parce que c’est là que ça aura le plus de retentissement. Il faut éviter d’être lu par un petit nombre seulement, et c’est dans des revues plus lues et plus générales qu’on va porter la discussion et le débat. On constate ensuite, notamment avec la revue Culture et musées, que le débat s’ouvre. Il a fallu convaincre de l’importance d’entendre le genre sous toutes ses facettes, en incluant non seulement les problématiques féministes mais aussi les perspectives LGBTIQ+. Selon moi, la vraie réussite de ce numéro est d’être parvenus à l’ouvrir avec la traduction d’article de méthodologie portant sur le queer au musée, et qui était resté jusqu’alors très confidentiel. C’était un article publié dans une revue suédoise LGBTIQ+, très intéressant et qui mérite justement d’être lu ailleurs que dans un territoire conquis. Beaucoup de propositions nous sont arrivées, de nombreux jeunes chercheurs et chercheuses ont voulu collaborer avec nous, ce qui a finalement donné lieu à une journée d’étude plus spécifiquement ancrée en histoire de l’art et qui a eu beaucoup de succès
Auriez-vous une définition des études de genre, et une réflexion sur comment elles s’articulent avec le monde contemporain ?
Je suis dans un laboratoire estampillé genre et sexualité, mais je considère aussi ces études comme une vraie boîte à outils, comme une manière de regarder différemment les choses. Je n’oublie pas mon ancrage disciplinaire, c’est l’histoire de l’art et ça l’a toujours été. Les études de genre m’apportent ce liant théorique, cette autre manière de voir, nécessaires. C’est un plus qui n’est pas un bonus car il est compliqué de réécrire une histoire, ce n’est pas cela qui m’intéresse, en tous cas, c’est le lieu de beaucoup de questionnements : comment relire, quelles chronologies employer. Dans mon nouveau projet personnel sur les femmes et les savoirs sur l’art, toutes ces questions se posent aussi. Dois-je vraiment commencer au XVIIIème siècle, quels cadres doit-on respecter… ? Je pense plutôt devoir aborder les choses de manière plus fragmentée. Tout comme l’écrivait Griselda Pollock, le musée
féministe doit être un musée complètement autre que ce qui a été pensé jusqu’alors, il faut penser différemment les temporalités, les structures, les organisations et les modalités. C’est la remise en cause de tout un système, une nouvelle grille de lecture, un nouveau canevas. C’est un espace de liberté, mais qui peut également être très perturbant, parfois dans le bon sens du terme !
Avez-vous déjà rencontré des objections radicales à vos sujets ou votre manière de les traiter ?
Oui, quand j’ai passé les auditions de maître de conférences, on m’a dit : « mais vous ne travaillez que sur les femmes. ». J’ai dit, « Est-ce-que vous demandez à mon collègue pourquoi il ne travaille que sur les hommes ? ». Je pense qu’un sujet comme ça, à l’époque, ne serait pas passé à l’université. Mais il y a eu les élections de Giovanna Zapperi en tant que professeure à Tours, d’Anne Lafont aussi à l’EHESS, on voit maintenant que c’est un champ qui a sa légitimité et qu’on titularise. On a trop longtemps pensé que ce genre de sujets étaient à la marge, périphériques. On m’a également fait le reproche, dans mon livre, de parler d’œuvres considérées comme mineures, donc qu’il n’était pas très important d’en parler. Le problème, et ce n’est même pas ce qui m’intéresse, n’est pas de dire si elles sont mineures, mais pourquoi elles sont considérées de la sorte : ce sont tous ces phénomènes de conditionnements, de formations différentes, et de perception du chef-d’œuvre au masculin, alors qu’il y a des travaux d’aiguilles très très beaux. On peut essayer de regarder autre chose. Elargir la focale.
En quoi ce genre de travaux servent-ils ou se lient-ils au monde contemporain ?
Travailler sur le genre, c’est évidemment travailler sur la déconstruction des assignations, des catégories mais c’est aussi travailler sur les rapports de pouvoir, donc de domination. L’actualité autour du harcèlement par exemple, rappelle sans cesse tous les propos misogynes trouvés et lus pendant la première année de ma thèse. Il y a une prise de conscience du monde sur ces questions-là, alors qu’elles ont toujours existé. Le harcèlement, je le traite dans ma thèse notamment sur le rapport maître-élève et par le biais de la caricature on voit très clairement qu’il y a des rapports de pouvoir, hiérarchiques, que la femme est renvoyée à sa sphère domestique. C’est le travail de l’histoire, tout court, que de faire des liens, de regarder, de prendre conscience que ça a toujours existé. On finit par se demander si histoire rime avec progrès…pourtant, on avance. On est quand même à un carrefour, il y a une prise de conscience institutionnelle très forte : de mon inscription en thèse à aujourd’hui, je vois l’évolution. Il a eu des jalons, des expositions qui ont éveillé les musées sur ces enjeux-là. Après, il y a encore des résistances : comme tout progrès, émancipation ou avancée, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ces résistances sont parfois assez cruelles. En employant le terme de « matrimoine », qui existe depuis le XIIème siècle, on a eu des retours de collègues parlant de ce terme comme de la novlangue. Pourtant, j’essaye de ménager les sensibilités. Il faut se blinder, je le dis à mes étudiants. Ma première intervention dans un colloque a été brutale également, je me suis faite reprendre assez violemment. J’ai appris plus tard que cela été dû au fait que je marchais, avec mon sujet, sur les plates-bandes de la personne concernée. Pour une première intervention, ça marque, je suis rentrée en pleurs, ai tout remis en question, puis me suis dit que si je croyais en mes convictions, il fallait que je les assume. Mais on tombe aussi sur beaucoup d’entraide : Plumes et Pinceaux, un ouvrage où Anne Lafont m’a invitée à participer, a été une vraie collaboration, un vrai beau projet collectif et solidaire. Elle incriminait en quelques sortes l’institution INHA, avec l’anecdote qu’elle raconte souvent, celle de n’avoir trouvé qu’une femme et demie dans le dictionnaire des historiennes de l’art (car une de ces deux femmes était mariée et n’a bénéficié que d’un demi article à côté de celui réservé à son époux). Cette collaboration aide, à se blinder, et à continuer ces études. Et l’évolution se fait par les jeunes générations, je le vois. Devant le flot d’étudiants qui veulent aborder ces sujets, des professeurs qui n’avaient jamais approché ces questions vont se dire que ces perspectives de recherche doivent être considérées. On est sur la bonne voie, j’ai l’impression.
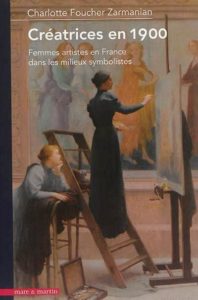
Save the date: visite d’atelier au 6b le 25/04/19
Les gestes engagés des femmes performeuses du 6b N'avez-vous jamais rêvé de vous glisser derrière les rideaux opaques de la scène, avant que le jeu ne commence? Vous êtes vous déjà imaginé sortir de votre rôle de spectateur pour enfiler un manteau d'assistant ou...
lire plusBerthe Weill (1865-1951), la marchande d’art méconnue
Photographie de Berthe Weill, c.1900, ©collection de la famille Weill Si l’intérêt envers les femmes artistes est grandissant depuis deux décennies, grâce aux efforts d’historiennes de l’art féministes notamment, un pan entier de la sphère artistique a pour le moment...
lire plusL’art et ma carrière
Lors de notre soirée de lancement, parmi la foule, une jeune artiste vient à notre rencontre. Elle se présente, Olivia Hernaïz, et nous parle de son travail. Sa pratique questionne l’efficacité et la légitimité des fictions humaines créées par l’espèce humaine afin de coopérer et vivre ensemble. Ce soir là, elle évoque avec nous son beau projet « L’Art et Ma Carrière ».
lire plus
Visite de l’Atelier Le Midi
cARacTères association vous propose de partir à la rencontre de Léa Dumayet et Morgane Porcheron dans leur atelier, l’Atelier Le Midi, au 52 Rue du Midi à Montreuil.
lire plus
Interview de Léa Dumayet
Léa est une artiste sculpteure* diplômée des Beaux-Arts de Paris en juin 2014 avec les félicitations du Jury. Cette distinction lui permet de réaliser sa première exposition collective avec les autres lauréats, dans l'enceinte du Palais de l’École. Elle y rencontre...
lire plus